Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?

Ce texte fut d’abord écrit en anglais à l’endroit d’amis qui me demandaient mon point de vue sur la situation de mon pays, le Burkina Faso. Répondant à une telle requête, j’ai rédigée ce long courriel que j’ai au final décidé de partager avec tout le monde (avec les changements nécessaires). Je sais que l’approche que je suggère n’est pas celle qui a été choisie ni celle qui va l’emporter à la fin des négociations sur la transition.
Cette semaine (10-17 Novembre 2014) un gouvernement transitionnel, ou à tout le moins un président de la transition, sera désigné. À l’évidence, je ne cherche pas à être du côté de ceux à qui les faits de l’Histoire sourient. Ce courriel exprime juste le fond de mes pensées, et appelle à la réflexion sur les vrais problèmes de la nation burkinabè, à savoir les problèmes socio-économiques de sa population et les voies et moyens de leur résolution.
La situation politique au Burkina Faso est bien complexe, après la chute du régime du Président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans, suite au soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2014. Cependant, si elle a un trait distinctif, c’est bien l’absence de confiance entre les différents acteurs : les hommes politiques ne se font pas confiance entre eux, et encore moins à l’armée. Les suspicions entre civils se sont révélées à plusieurs endroits, notamment par les échanges verbaux entre le Balai Citoyen et l’opposition politique sur la paternité du succès de la révolte des 30 et 31 octobre. Elles se reflètent également dans les négociations actuelles relatives à la transition sur l’accent mis sur l’intégrité des individus qui y participeront ou la dirigeront ou sur leur non-appartenance à un parti politique. En fait, ceci ne devrait même pas être mentionné, puisque tous les Burkinabè sont censés être aussi intègres que leur sang est rouge. Requérir d’un Burkinabé de l’intégrité est sans doute l’un des exemples les plus parlants de pléonasme, malheureusement désormais nécessaire.
Quant à l’armée, elle est suspectée, sinon accusée de vouloir se maintenir au pouvoir directement en prenant contrôle du pouvoir d’État, ou à tout le moins aux travers de marionnettes qui agiraient pour son compte. À ces critiques, les engagements du Lt. Colonel Zida dès les premiers jours où il assuma de fait un pouvoir vacant à l’appel de la société civile n’ont pas suffi. On remarquera néanmoins que tous les acteurs qui ont eu à discuter directement de la situation nationale avec le Lt.-Colonel Zida se sont dits rassurés de sa bonne foi et de son désir de rendre le pouvoir aux civils dès qu’un gouvernement de transition aura été constitué. Ainsi, la CEDEAO a salué le professionnalisme de l’armée dans la gestion de la crise et a loué son engagement positif dans la recherche d’une solution. Qualifiant la situation actuelle d’insurrection populaire, elle a même appelé l’Union Africaine à ne pas adopter les sanctions automatiques prises en cas de coup d’État que celle-ci brandissait fiévreusement. Les chefs religieux et coutumiers, les organisations les plus représentatives de la société civile, les syndicats, les dirigeants de l’opposition politique et bien d’autres semblent tous regarder avec une certaine bienveillance, mais en toute vigilance, l’armée dans ce mouvement. Il est toutefois certain que tant que la poussière soulevée par les marches des 30 et 31 octobre ne se sera retombée, il est bien prétentieux pour quiconque de prétendre avoir une vision claire tant du récit des évènements que du rôle et des agendas des différents acteurs. Voici pourquoi même en ces périodes d’incertitude et de doute, il faut faire preuve de retenue et de distance. Les conséquences d’une simple erreur de jugement hâtif peuvent être dramatiques. Il faut laisser aux uns et aux autres le crédit de la bonne foi, jusqu’à preuve du contraire.
Le manque de confiance entre les différents acteurs a dicté l’objet et imposé des limites objectives aux ambitions des négociations sur la transition, en simplifiant le problème burkinabé et en le résumant à l’équation suivante : (1) comment s’assurer que la transition soit aussi brève que possible, (2) avec le moins d’interférence possible de l’armée, et (3) sans porter atteinte aux aspirations des différents acteurs politiques de se présenter aux élections présidentielles et législatives à organiser d’ici novembre de l’année prochaine. Pour la même raison, les différents acteurs n’ont pas essayé de s’attaquer à la tâche plus ambitieuse de réfléchir et de proposer de véritables solutions aux préoccupations quotidiennes des Burkinabè. Ces défis ne semblent même pas pour l’instant inscrits sur l’agenda des discussions. Comment garantir à tous les Burkinabè leurs trois repas quotidiens, la chance d’aller à l’école et d’avoir un système de santé efficient ? Comment fournir à cette très jeune population les conditions nécessaires pour qu’elle puisse poursuivre ses rêves et avoir le sentiment que sa vie a un sens et un but dans le cadre des lois et de la République ? Comment donner à nos jeunes la foi pour qu’ils ne trouvent pas la vie profondément injuste, mais au contraire équitable ; qu’ils aient foi qu’à la place du paresseux, de la tricheuse et du corrompu, le travailleur, l’homme honnête et la femme intègre seront couronnés de succès dans leurs œuvres et couverts des honneurs de la société ? Sans surprise, les négociations sur la présente transition n’ont pas adressé la lancinante question suivante : est-ce que le système politique vers lequel nous nous acheminons, fondé sur la victoire de la majorité aux élections, et semblable sous cet aspect à celui que nous avions sous le régime du président Compaoré, est la réponse la plus adaptée à nos besoins de Justice, de justice sociale et de développement ?
Dans ces conditions, j’ai bien peur que dans 20 ans, ma fille ne soit à son tour contrainte de descendre dans la rue pour « chasser » son président pour les mêmes raisons qui sont les causes lointaines mais réelles de la révolte contre le régime du Président Compaoré. Bôgô ba ra ou du « travail de sable » en dioula ; Pénélope et Sisyphe en Afrique. Comment faire que chaque dix, vingt ans, des troubles pareils ne se produisent plus au Burkina ? Comment s’organiser pour que dans dix, vingt ans, il n’y ait pas de laissés-pour-compte pour crier leur ras-le-bol ? N’a-t-on pas besoin de plus de temps pour mieux réfléchir à nos échecs et à nos succès et tracer à la fois un contrat social entre le peuple et ses dirigeants et un projet social qui répondent aux préoccupations de ces jeunes qui ont offert leurs poitrines aux balles pour le rêve d’un Burkina Faso intègre et plus juste ? Formaliser, aseptiser une révolte dans des processus formels de dévolution du pouvoir politique, ce n’est que retarder l’échéance de nouvelles contradictions sociales, toutes aussi violentes.
À mon avis, nous devrions plutôt mettre l’accent sur la réflexion pour trouver des solutions aux problèmes structurels ci-dessus mentionnés, au lieu de nous focaliser sur les règles et la procédure de dévolution du pouvoir politique. Ces dernières doivent s’adapter à nos objectifs et non l’inverse. Dans la situation actuelle, la Communauté internationale n’est pas d’un secours utile, pressée telle qu’elle est de tourner la page de l’ « épisode Burkina Faso ». Ainsi, l’Union Africaine a imposé un délai de deux semaines pour rendre le pouvoir à un civil. Elle ne semble intéressée que par un prompt retour à une « vie » constitutionnelle normale, à ce que je qualifie de démocratie formelle, celle des cimetières où les populations continuent à endurer leur misère, mais ont un droit à un bulletin de vote dont parfois elles ne comprennent pas toute la portée. C’est vrai, la démocratie formelle est très paisible et pacifiée parce que dans celle-ci, comme dans les cimetières, les gens sont morts à leurs rêves et à leur potentiel.
Je comprends que le défi de recréer un Burkina Faso plus juste et de transformer les Burkinabè en ce qu’ils sont déjà, est un chemin long et difficile. Des amis ont attiré mon attention sur le fait qu’un tel programme serait sans doute au-delà des objectifs d’une transition. Le professeur Loada a ainsi affirmé hier que « [f]inalement, je crois qu’il faut se concentrer sur l’élection pour sortir de cette situation qui n’arrange personne. Il y a des questions lourdes, de réconciliation nationale, de refondation de la démocratie, qui ne peuvent pas trouver réponse en quelques mois ». C’est sans doute vrai, mais à la condition de prendre le cadre figé d’une transition classique comme élément de référence indispensable et nécessaire pour sortir de notre situation. En réalité, au lieu d’un gouvernement de transition vers une démocratie formelle, il est fort possible d’imaginer un « gouvernement de mission » à qui l’on assignerait certaines tâches bien précises à résoudre allant au-delà de l’organisation de simples élections, et incluant l’élaboration du projet politique et social commun. Pareil gouvernement de mission ne serait pas assujetti aux contraintes temporelles qui pèsent sur les gouvernements de transition. Tout est possible sous le soleil, à condition de vouloir l’imaginer et de vouloir y mettre les forces nécessaires.
Je suis également sensible à l’argument selon lequel l’important et la priorité du moment consistent à remettre en marche les institutions « démocratiques » et de laisser au processus politique la tâche de répondre aux soucis de Justice, de justice sociale et de développement des Burkinabè. « Une chose à la fois », serait-on tenté de me dire. Néanmoins, je ne suis ni certain que la peur face à l’énormité d’une tâche ou la paresse doivent dicter nos choix ni que le jeu normal de la démocratie formelle puisse résoudre ces défis. En fait, il se pourrait qu’on ne soit qu’entrain de changer nos chaînes avec de nouvelles, sans doutes belles, mais toutes aussi privatives de liberté et d’espoirs. J’ai l’impression qu’une chance est entrain de passer sous notre nez. S’il est vrai que les jours sont incertains, ils paraissent néanmoins inviter la possibilité de re-imaginer notre projet politique pour le Burkina Faso ainsi que le contrat social entre nous et nos dirigeants. En même temps, je ne suis pas pessimiste. Pareilles fenêtres d’opportunités se reproduiront dans le futur. Mais, à quel coût, et, plus crucialement, quand ?
Pour les besoins de la clarté, mon propos n’est pas que l’armée doive rester au pouvoir et gouverner le pays. Mais en toute franchise, cela ne me dérangerait pas outre mesure. En sens inverse, je ne suis pas non plus convaincu qu’il est indispensable que l’armée demeure au pouvoir, comme certains le prétendent. À vrai dire, dans ma perspective, l’identité de l’exécutant m’intéresse peu, s’il est en mesure d’accomplir la tâche qui lui est confiée. Après tout, il n’est qu’un exécutant d’options politiques choisies de manière consensuelle par tous les acteurs et peut dès lors être remplacé selon les règles de l’art dès qu’il réalise ou fait montre de son incapacité à assumer les charges qui lui sont confiées.
Au final, mon point de vue est simplement le suivant : l’urgence de l’heure, c’est de définir le projet politique des Burkinabè ainsi que le contrat social entre eux et ceux appelés à l’exécuter. Je crains qu’on ne déclenche une bombe à retardement en laissant exclusivement aux vainqueurs d’élections régulières la tâche d’élaborer à eux seuls le projet politique du pays, sans inclusion des autres acteurs sociaux, notamment la société civile. J’ai peur qu’on ne sème les graines de futurs troubles en ne précisant pas les termes du contrat social qui lie les exécutants au peuple et à ses différentes composantes. Il est indispensable de pouvoir évaluer leur travail sur la base de critères tangibles. Nous le savons tous, dans notre pays les élections se font ad personam et non sur la base d’un programme politique donnée. Alors pourquoi leur attacher nécessairement l’effet d’un blanc-seing pour le programme politique du vainqueur s’il en a ? Le Professeur Laurent Bado affirmait à qui voulait l’entendre qu’aucun des partis politiques au Burkina n’en avait de véritable. Je tremble donc à l’idée que dans dix, quinze, ou vingt ans, quand le nombre des marginalisés du système aura de nouveau explosé une nouvelle révolte ne survienne.
À bien y réfléchir, chaque fois qu’il y a des troubles en Afrique, des Gouvernements dits d’union nationale sont mis en place afin de tromper la faim, la soif ou la colère des populations et apaiser les tensions politiques. Malheureusement, jusque-là, nous n’avons pas encore essayé le Projet national commun et consensuel de société. Ceci reflète, à mon avis, d’une part, notre focalisation sur les individus et non leur ordre de mission, ainsi que notre attention sur les élites politiques et la démocratie formelle et non sur les besoins ou les défis des peuples africains. Au final, nous essayons d’élargir la table où soupent et dînent quelques rares privilégiés, tout en ignorant la souffrance de la grande majorité rampant à leurs pieds à la quête de miettes.
J’aurais aimé dans cette situation du Burkina Faso que l’on ignore un instant le facteur temps, qu’on évite la précipitation vers un système dont on n’a pas examiné la capacité de résoudre nos problèmes. En revanche, il est temps de s’attaquer à ces « questions lourdes, de réconciliation nationale, de refondation de la démocratie » et au problème plus fondamental, à mon avis, de la définition d’un projet de société commun et consensuel. Pour ce faire, un consensus entre tous les acteurs politiques est indispensable, d’où la nécessité d’un dialogue franc et sans agenda caché entre tous les acteurs. Nous avons besoin de présenter notre manière de résoudre toutes les questions soulevées par l’insurrection populaire d’octobre 2014 d’une voix unie, notamment notre projet politique commun et consensuel de développement socio-économique. C’est pourquoi dans ma première réaction sur la situation nationale publiée le 2 novembre sur ma page Facebook, en réaction à l’appel de l’opposition à la marche dite contre le « vol de la révolution par l’armée », j’avais appelé tous les acteurs : (1) à se laisser les uns les autres – y compris l’armée et le Lt.-Colonel Zida – le bénéfice de la bonne foi et du doute, sous réserve de la preuve établie du contraire, tout en demeurant vigilants ; (2) à mettre fin aux marches de protestation pour l’instant ; et (3) à s’asseoir et discuter avec tous les acteurs pour atteindre un consensus national sur les problèmes de l’heure. Je remarquais que :
« Aujourd’hui, tous les Burkinabè, y inclus nos frères et sœurs de l’Armée, savent que le peuple burkinabé peut chasser qui il veut du pouvoir s’il ne se tient droit. Prométhée a volé le feu sur l’autel des dieux d’une certaine conception de la démocratie directe et nous l’a donné. Allons-nous l’utiliser judicieusement pour illuminer nos pas vers l’avenir de notre pays ou l’utiliserons-nous pour brûler nos cases. Pourquoi ne pas discuter d’abord autour de la table et ne commencer les marches qu’après l’échec des négociations ? »
Dans ce sens, je me dois de féliciter la décision de l’Opposition politique et de l’Union d’Action Syndicale de suspendre leurs mots et appels à des marches ou grèves. C’est à la seule condition d’un consensus national entre les acteurs de la nation que la Communauté internationale va s’abstenir de nous imposer la démocratie formelle, celle des cimetières où « le gouvernement gouverne, l’opposition s’oppose, et le parlement “parle” ». Tout bouge ; rien ne change. Si la Communauté internationale trouvait en notre sein la moindre division, elle préfèrera la paix, la stabilité et la démocratie des urnes, même si ces éléments ne veulent dire que peu de choses pour le pauvre, la veuve et l’orphelin qui constituent plus de 90% de notre population. C’est l’heure de faire preuve de hauteur d’esprit, de patriotisme désintéressé et d’un sens profond du sacrifice.
Je ne me fais pas d’illusion sur les suites qui seront accordées à mon message. Après tout, il n’est qu’un courriel privé adressé à des amis. Cependant, certaines causes perdues sont dignes de nos efforts, surtout lorsqu’elles résonnent au plus profond d’un cœur. Tôt ou tard, les Burkinabè devront discuter et élaborer le nouveau contrat social entre eux et leurs dirigeants politiques, ainsi qu’un nouveau projet de société pour le Burkina Faso et sa population, pour une société plus juste et intègre, tant pour le riche que le fort, mais surtout pour le pauvre et le faible. À tout le moins, tel est mon espoir, ma prière.
PS : Plusieurs amis m’ont proposé d’être un peu plus concret sur les linéaments du contrat social entre gouvernants et gouvernés et sur la mise en œuvre concrète du projet de société consensuel qui sont au cœur de mon approche. C’est une réflexion déjà entamée que je publierai très bientôt et j’encouragerai tout burkinabé à réfléchir et à proposer sa manière de le voir. C’est dans la multitude des idées qu’émerge le bon chemin. L’objet de la présente contribution était de souligner le fait qu’on occultait peut-être un aspect fondamental de la question burkinabé qui risquait de nous revenir dans un futur proche ou lointain.
Mamadou Hébié

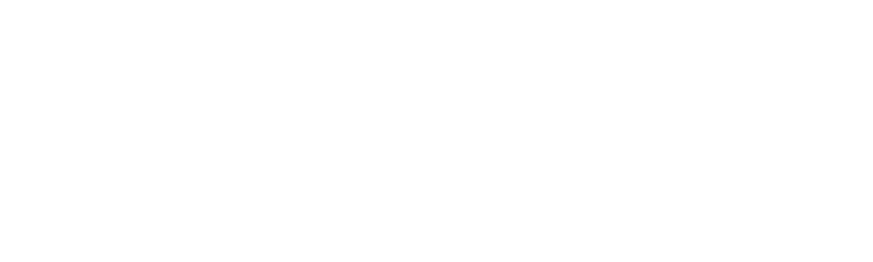
Vos commentaires
1. Le 13 novembre 2014 à 15:02, par Plinus Pulcher En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
Vous abordez des aspects très importants dans votre contribution. L’essentiel est en effet occulté au profit des pacotilles : on parle plus du pouvoir, i.e. des postes (c’est comme ça qu’ils voient la transition), que de ce qu’on veut en faire. Et c’est là une très grande erreur, source, prochainement, de révoltes pires que la présente. Le peuple ne s’est pas opposé à Blaise parce que c’était Blaise ; il était opposé à un mode de gouvernement, i.e. de gestion, qui ne tient pas compte des aspirations du peuple. Sinon, Blaise pouvait faire 1000 ans, si le peuple trouvait le bonheur avec lui. Il faut donc que les acteurs actuels du processus de transition aient plus cela en tête que les postes. Le risque le plus grave pour le Burkina, est que, à force de courir derrière la démocratie formelle, nous mettions à la tête de l’Etat, demain, des gens pires que le régime Compaoré (détournement, népotisme, copinisme, etc. : ce n’est pas une vue de l’esprit, on l’a vu dans les pays voisins qui viennent de traverser ou traversent les crises ; ceux qui sont arrivés au pouvoir passent leur temps à s’acheter les Boeings, conclure les marchés sans appels d’offres, etc., commissions pour intermédiaire à 25 milliards, etc., pendant ce temps le peuple continue de souffrir des mêmes maux qu’il dénonçait).
Mais il y a une chose que vous devez avoir aussi à l’esprit, et qui ne peut que rendre irrésistible la course au formalisme démocratique creux, au mépris des aspirations réelles populaires : nos amis de la "communauté internationale" ne nous laisseront jamais les mains libres, pour la simple raison que c’est eux qui tiennent le cordon de la bourse. Les Américains par exemple font une fixation sur les délais (brefs), la qualité de la personne (civile), et surtout sa mission (organiser élections), et donnent presque des ordres. Que peut faire le BF contre çela ? Rien. Après les mêmes, pour se moquer de nous, vont nous rabattre les oreilles avec les mêmes termes flegmatiques du droit international comme la souveraineté, l’égalité, etc.
Pour me résumer, je crois que la pression extérieure inévitable (i.e., même si nous sommes d’accord entre nous sur quelque chose, pourvu que la communauté internationale ne le veuille pas) que nous devons admettre, par réalisme, comme partie intégrante de l’équation, peut justifier que nous acceptions renverser la perspective, en organisant une transition brève, quitte à ce que nous décidions, dans le long terme, de refonder notre gouvernance (il suffit que la même détermination qui a conduit au soulèvement demeure).
2. Le 13 novembre 2014 à 15:44, par burkinabé intègre En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
Merci mr HEBIE pour cette mise au point .Je partage entièrement votre contribution. L’opposition n’évoque que des problèmes purement politiques en l’occurrence la désignation du chef de l’Etat, la formation de tel organe, les conditions à remplir pour être membre de tel ou de tel organe etc.. Cela donne l’impression que l’opposition ne tire pas leçon des raisons qui ont entrainé la chute du régime de la quatrième république à savoir le pillage de nos ressources jugées maigres, la corruption, la vie chère, le mauvais traitement des travailleurs avec des broutilles appelés salaires, les mauvaises conditions d’études des élèves et étudiants, l’impunité, l’insouciance érigées en mode de gouvernance .Donc le peuple, fatigué de crier son râle-bol a décidé de tourner définitivement la page du régime et compter sur une autre personne capable d’apporter des éléments de réponse à leur préoccupation. c’est dire donc que les principales tâches qui attendent le futur pdt sont entre autre les problèmes soulevés plus haut. Il est vrai que la désignation du nouveau pdt doit se faire dans les règles de l’art mais ce qu’il doit faire une fois au pouvoir est encore plus important que sont choix. Et c’est maintenant qu’il faut le définir en présence de toutes les forces vives de la nation, il faut lui donner une feuille de route prenant en compte les véritables problèmes des burkinabés sinon on ne pourra pas l’évaluer alors que son évaluation est indispensable. Il est donc plus important de tracer les sillons en vue de la résolution de ce problème de fond au lieu de s’attarder sur la forme. Mr Hébié a donc vu juste en attirant votre attention. Que dieu bénisse le Burkina et son peuple
3. Le 13 novembre 2014 à 17:15, par Sampa En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
Belle analyse.Allons au delà de ce soulèvement populaire pour comprendre les soucis du Burkinabé,qui a faim et soif, bref sans perspective .Les mêmes causes produisent les mêmes effets.Alors politiques et militants ,ne nous échouez pas.Demain sera meilleur.
4. Le 13 novembre 2014 à 17:32, par amy En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
Taisez-vous svp ou étiez-vous quand c’était chaud ? Et pourquoi n’aviez-vous pas levé le petit doigt quand régnait le grand sachem ?
5. Le 13 novembre 2014 à 18:03, par fanfan En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
Je je et je, et encore et toujours je. Où étais -tu quand blaise et le cdp nous pompaient l’air
6. Le 13 novembre 2014 à 18:32, par anan En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
nous ne voulons plus danalphabete dans notre systheme polique.le minimum le BAC.il est inadmissible qu’un individu avec le niveau zero dicte les lois a un maitrisard....
7. Le 13 novembre 2014 à 18:54, par Cheikh En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
Vraiment ! Quand chacun prend le train en marche comme çà, pour vouloir apporter ses bons offices maintenant, et sans nous dire qui il est ni qu’est ce qu’il fait, on est en droit de se demander où il était, lorsque déjà les Niamsi et les Djibo bravaient avec insolence nos braves défenseurs comme Sawadogo, Dabiré Kwesi Christophe, Sayouba Traoré, Tuorozi Hervé et autres....
8. Le 14 novembre 2014 à 00:14, par Oumar DJIGUEMDE En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
l’éloquance, le fond et votre modestie ont prévalus à mon silence. merci pour votre apporche.
je m’envoudrais de ne pas repondre favorablement à un tel projet, mais acceptons que le retoure à la vie constitutionnelle est plus que nécessaire aujourd’hui d’autant plus que le Burkina est économiquement dependant.
9. Le 14 novembre 2014 à 00:41 En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
J’ ai peur maintenant, deh ! Mes esclaves veulent devenir intelligents. Vite vite vite, les ai-claves qui sont toujours restes loyaux, accompagnez- moi dans la brousse pour que je prenne mon avion. Je prends pas mon avion a Ouaga Aeroport. Vous mieme vous voyez. Ouaga - Donsin, c’est pas encore pret. Donc, Nobere- brousse vale mieux qu tous.Tout s’ est foute s’ est gate. Un homme fort nous a ouvert la voie. Quand ca va pas, faut fuir deh !
10. Le 14 novembre 2014 à 00:43, par Vif En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
Mon frère tu as raison ! Pendant qu’on discute sur les positionnements des uns des autres, moi ce qui me dérange c’est que l’ancien régime détient toujours les rennes économiques. Qu’est ce qui a été fait pour arrêter hémorragie le temps de voir clair ? Les sociétés écran (dites de prête-nom) sont légions, il faut déjà localiser les investissements de certains caciques de l’ex-régime. Je suis certains que bcp de ces boites ne payaient pas les impôts. Les conventions secrètes avec les mines, les dossiers en justice qui ont été piétinés pendant si longtemps par les procureurs eux-mêmes, etc. IL y a un certain nombre de chose à gérer dans un futur immédiat avant même de disposer d’une équipe dirigeante en place. J’espère que ZIDA veillera à prendre les mesures conservatoires dans tous les domaines de la société car je sens qu’à force de tergiverser beaucoup de choses vont nous échapper les gens ayant eu le temps de se "couvrir".
11. Le 14 novembre 2014 à 01:17, par wendy En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
bonne réflexion. Les projets de société devraient être pensés et proposés par les politiques surtout quand ils prétendent a la magistrature suprême. Et c es sur cette base qu on devrait les juger Hélas !!! En ce qui concerne 2015 c est la course (en rang dispersé) vers les élections qui s annonce et aucun politique ne pourra sérieusement nous présenter quelque chose de différents ou de nouveau
Du reste j espère que de telles réflexions peuvent être menées à travers des structures ou institutions permanentes de l État. Hâte de vous lire prochainement. Thx
12. Le 14 novembre 2014 à 13:56 En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
Une très bonne analyse mon frère, que le tout puissant te bénisse, t’éclaire d’avantage pour aider ces politiciens et leurs alliés à s’attaquer aux difficultés réelles de la population burkinabé, qui s’est sacrifié et qui aspire à un vrai changement. Chapeau à toi.
13. Le 14 novembre 2014 à 17:15, par Espoir En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
Belle et juste analyse M. HEBIE. Cependant je trouve personnellement que vous mettez la charrue avant les bœufs. En effet, je pense que la transition est nécessaire actuellement sur les 12 mois et il faut absolument mettre en place une structure qui puisse continuer à gérer les affaires courantes du pays. C’est tout à fait normal donc que l’on puisse trouver les oiseaux rares pour gérer cette transition. Après et seulement après ces douze mois donc en novembre 2015, les partis politiques qui vont se présenter aux élections devront présenter des programmes politiques qui tiennent compte de ce que vous dites. A cela il faut donc dès maintenant arriver à sensibiliser la population pour qu’elle sache choisir suivant les programmes et non leurs ventres ! Personnellement je ne cautionne pas un travail d’ensemble comme vous le préconisez pour trouver la voie à suivre, il faut une pluralité. Il faut que chacun puisse présenter son programme et permettre à l’ensemble des burkinabè de choisir celui qui se rapprochera le plus à leurs attentes.
14. Le 15 novembre 2014 à 11:22, par judi En réponse à : Situation politique au Burkina Faso : Et si on s’attaquait aux problèmes de fond ?
je pense que mon ami a raison de s’inquiete mais qu’il sache que plus rien ne se fera ds ce pays qui ns est cher sans la participation de notre peuple.nous ne pouvons pas stoper definitive et surtout immediatement la corruption,l’impunite...mais je vs assure que ns sommes sur la bne voie,plus rien ne sera comme avant et aucun politique ne s’hasardera encore a se moquer de notre peuple.a bas le cdp,a bas le fedabc et malheur aux gouvernants qui baillonnent leurs peuple LA PATRIE OU LA MORT NS VAINCRONS !