Groupes d’autodéfense : Les koglwéogo s’invitent dans les laboratoires de recherche
LEFASO.NET | Par Tiga Cheick Sawadogo

Le phénomène social que sont les groupes d’autodéfense, au-delà des débats passionnés qu’ils suscitent, est un vaste champ de recherche qu’investissent les fins limiers des universités et autres instituts de recherche. Une collaboration entre chercheurs de l’université Ouaga1 Pr-Joseph-Ki-Zerbo du Burkina et de Zurich en Suisse a encore permis de prolonger les questionnements sur ces groupes, notamment sur leur légitimité. Les Dr Zakaria Soré, Bouraïman Zongo et Muriel Côte ont investi le terrain des Koglwéogo pour des recherches. Dans la soirée du 12 février 2019 à Ouagadougou, ils ont partagé les résultats de leurs travaux avec des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des doctorants, des étudiants...
La salle 401 de l’Unité de formation et de recherche (UFR) en Sciences humaines de l’Université Ouaga1 Pr-Joseph-Ki-Zerbo a refusé du monde dans la soirée du 12 février. Assurément, le sujet qui devrait faire l’objet d’échanges, toujours d’actualité, méritait bien le déplacement. Au-delà des commentaires de tous ordres, des jugements sans réels fondements, le recul des chercheurs pour creuser et questionner s’imposait.
La légitimité des Koglweogo est un travail qui a été mené par le laboratoire Genre et développement de l’université Ouaga1 Pr-Joseph-Ki-Zerbo et celui de Géographie politique de l’université de Zurich. Muriel Côte a présenté le projet de recherche, la problématique qui a guidé le travail et les objectifs poursuivis. Quant au Dr Zakaria Soré, il a épluché les résultats auxquels le trio de chercheurs est parvenu, tout en évoquant les difficultés rencontrées dans sa conduite.
Selon Dr Muriel Côte, l’équipe a essayé de comprendre les origines de l’émergence des Koglwéogo au Burkina Faso, les enjeux sécuritaires de cette émergence, leurs actions sur le terrain, afin de faire des analyses. Depuis mi-juin 2017 et ce pendant 18 mois, l’équipe a parcouru les localités comme Kao, Mané, Manéga, Séguénégua, Kongoussi, Sapouy, Kombissiri, Nioko, pour rencontrer les groupes d’autodéfense, les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives...
Entre légitimité et légalité
Les Koglwéogo ne sont pas nés ex-nihilo. Ils sont apparus dans un contexte d’ « Etat fragile » où les structures centrales peinent à satisfaire les besoins des populations. Celles-ci se sont vues dans l’obligation de s’organiser pour faire face à certains problèmes dont la gestion relève du rôle régalien de l’Etat. Les Koglwéogo sont nés dans ce contexte de « vigilantisme » qui se manifeste à travers la volonté des populations de prendre en charge elles-mêmes leur sécurité.
Dans les milieux d’émergence de ces groupes d’autodéfense, les populations se considèrent comme des laissés-pour-compte, des citoyens de seconde zone, oubliés par l’Etat. En plus des besoins de sécurité que l’Etat ne satisfait pas, laissant les populations surtout rurales face aux grands bandits qui les dépouillent de tout, les chercheurs ont aussi noté d’autres raisons qui fondent l’existence des Koglwéogo.
La suspicion de complicité entre les structures de l’Etat (Forces de sécurité et Justice) et les grands bandits. Selon les jeunes chercheurs, avec des exemples, les Koglwéogo tentent de convaincre qu’ils sont pris entre l’étau des malfaiteurs et l’enclume de ceux qui étaient censés veiller sur leur quiétude. S’organiser pour se défendre devenait une impérieuse nécessité pour ne pas disparaître.
Ce sont entre autres les raisons qui ont construit la légitimité des Koglwéogo. Très populaires surtout dans les zones reculées, ces groupes d’autodéfense agissent pourtant en dehors de toute légalité. La perception des taxes, les sévices corporels se font par exemple en violation de la loi. Les Koglwéogo sont ainsi un cas des contradictions sécuritaires de l’Etat importé. Le respect des lois face à une incapacité de l’Etat d’assumer son rôle régalien.
Une mimique qui crée la fracture
Les chercheurs, en faisant immersion sur le terrain pour discuter avec les acteurs, ont constaté l’unanimité sur les résultats des groupes d’autodéfense. L’insécurité, en ce qui concerne les braquages, a sensiblement diminué. Certains éléments des Forces de défense et de sécurité dans des localités réputées criminogènes ont ainsi reconnu que leur charge de travail a baissé.
Par contre, certains agissements des Koglwéogo commencent à créer une certaine fracture au sein même des populations qui applaudissaient leurs actions. Les Dr Zakaria Soré, Bouraïman Zongo et Muriel Côte qualifient certains comportements de mimiques de ce que l’Etat fait. Ainsi, les Koglwéogo s’octroient des grades, instaurent des tickets de vente de bétail, se confectionnent des badges, établissent des documents pour les convocations ou des ordres de mission. Cette donne crée la confusion chez les populations, ce qui contribue à créer la fracture entre les koglwéogo et les bénéficiaires de leurs services.
Dans tous les cas, le besoin social de sécurité qui est non-satisfait par l’Etat et qui a constitué un terreau fertile pour l’émergence des koglwéogo, ne permet pas de les vouer aux gémonies. Les exigences de l’Etat moderne ne doivent donc pas être une raison pour rejeter toute initiative qui permette de soulager les habitants de certains milieux qui ne bénéficient d’aucune présence de l’Etat. Par contre, certains ajustements sont nécessaires pour encadrer les actions de ces groupes.
La présentation des résultats de la recherche a donné lieu à des échanges nourris avec l’assistance. « On se rend compte qu’il y a beaucoup à aller chercher encore », a reconnu Muriel Côte qui encourage de ce fait les jeunes chercheurs à investir le terrain pour continuer à éclairer ce qui peut être considéré comme un renouveau de l’expression citoyenne dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes.
Tiga Cheick Sawadogo (tigacheick@hotmail.fr)
Lefaso.net

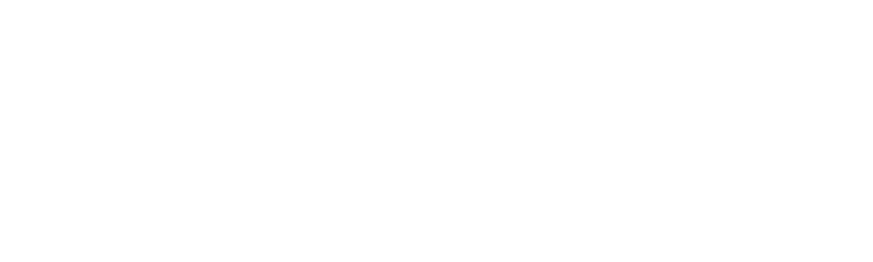



Messages
14 février 2019, 11:00, par *
Sid-Naaba
C’est ainsi qu’on vient nous pousser à s’exprimer pour ensuite aller se faire appeler specialistes de tel pays ou tel groupe ou expert dans tel domaine sans fournir d’efforts. La propriété intellectuelle doit être préservée.
14 février 2019, 11:24, par *
Véritas
Qui t’a empêché d’écrire, de mener des recherches et de publier tes résultats ? Toujours là à se plaindre pendant ce temps, les autres osent.
14 février 2019, 12:24, par *
Burkinabè
À mon avis la problématique de la recherche n’est pas claire car d’aucun burkinabè n’ignore l’origine de l’émergence des Koglwéogo dans le pays des hommes intègres.
C’est pour dire que l’on n’a pas besoin de poser celle-ci comme problématique de recherche.
Peut-être que c’est une étudiante qui fait son travail de mémoire de Master.
Que ce soit ainsi ou autrement, cette remarque n’engage qu’à moi car ça sera plus intéressant de savoir pour quelles raisons les Koglwéogo s’autodéterminent c’est-à-dire pour quelles raisons ils ne veulent pas se soumettre à la loi de la république.
Pour le dire autrement, est-ce que les Koglwéogo pensent que c’est nécessaire d’avoir une république dans la république légitime ? Et si oui, quelle forme de république envisagent-ils de créer au Burkina ? ,etc...
Pour finir, je profite de l’occassion pour vous dire que j’ai mené une recherche sur les difficultés d’intégration des ressortissants des pays tiers en Europe tout en examinant les anciens concepts issus des premiers sociologues de la fameuse Ecole de Chicago.
Ma prochaine recherche sera donc de connaître la logique des projets humanitaires intervenant dans les pays tiers ainsi que les buts qu’ils envisagent.
Pour ce qui est de la recherche sur le Koglwéogo, je vous souhaite une bonne suite.
Je reste à votre disposition.
14 février 2019, 16:17, par *
Messoh
Laisse tout ça là tomber, laisse tout ça là tomber cher Burkinabè. Il faut dire que tu voulais profiter faire ton pro dada Wai
14 février 2019, 13:03, par *
Kôrô Yamyélé
– Encore une ruse mossi pour nous faire avaler l’affaire des Koglwéogos qui ne sont qu’un ramassis de voleurs et de coupeurs de routes qui se recyclent dans une organisation illégitime !!
Par Kôrô Yamyélé
14 février 2019, 13:55, par *
Bernard Luther King ou le Prophete Impie
1) Merci Chers Chercheurs pour votre contribution precieuse au debat national pro-koglweoogo VERSUS anti-koglweoogo.
2) Je repetè ce que j’ai dej ecrit ici sur le FASO.NET : "il faut etre intellectuellement malhonnête et statistiquement illettré pour refuser de reconnaitre la dialectique sociale qui a donné naissance et legimité aux Koglweoogo" . Un mois à peine après cette declaration, une enquête mené par la Croix Rouge fut publié pour livrer les resultats d’un sondage national sur les Koglweoogo. Ce sondage entrepris sur les grandes parties du Territoire fait ressortir clairement l’utilité et la legitimité indeniable des ILS (Initiatives Locaux de Securité) : Koglweoogo, Dozos, Wendpanga.
3) Chers Chercheurs, je m’attendais à mieux qu’une narration en prose d’une question nationale de si grande importance. La credibilité d’une recherche, c’est les chiffres d’abord et rien que les chiffres. Malheureusement, je ne vois pas de chiffres à moins que notre journaliste ait oublié d’en parler. A ne s’en tenir qu’a cela, vous ne dites nullement mieux que moi en 2015 où je m’élévais contre l’InterSyndical des Professionnels du Droit ici sur ce forum.
4) Pour ce qui est de la legalité des ILS (ici des Koglweeogo), il n’y a pas meilleure ecrit que celui de la Société burkinabè du Droit Constitutionnel publié il ici y a pas plus de 3 mois. Selon la Constitution, les Koglweoogo ont le droit d’exister même informellement. Quitte a ce qu’il se regularise avec des recipissés.
5) De plus, Chers Chercheurs, des documents de recherche existent dejà sur les ILS : Voir l’Ecole de la Police, Voir le projet de mis en place de la Police de Proximité, etc. Vous auriez pu vous en enrichir.
6) Mes encouragements à vous Chercheurs : vous valez mieux que ces chercheurs de l’UCAO, et d’autres qui se sont fait entendre recemment de manière indigne de cette noble vocation de Chercheur.
7) Nos ILS ont besoin d’encadrement et autres comme je l’ai le plus tôt à la première controverse autour de 2015.
"Dieu est et reste Burkinabè"
14 février 2019, 14:14, par *
James
BELLE APPROCHE§
LES KOGLWEOGO FONT LA FIERTE DE LA POPULATION ABANDONNEE PENDANT DES ANNEES MAIS ILS ONT BIEN FAIT DE PROTEGER LEUR PROPRE PATRIMOINE.
17 février 2019, 07:39, par *
Lapaz
3 Dr pour pondre ça ? C’est vraiment dommage mais je crois qu’il ya plus urgent et plus important comme recherche à faire, à moins que ca ne soit pour l’argent de cette étude de Dr Coté que les deux autres on suivi le mouvement sinon sincèrement Dr Sore et Dr Zongo qui ne savait pas ce que vous avez dit ?