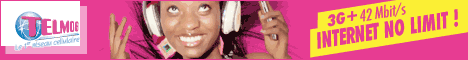Elles sont toutes des veuves d’anciens combattants. Aujourd’hui frappées de sénilité, beaucoup d’entre elles portent dans leur chair de graves stigmates liés au grand âge. Certaines ont perdu la vue, d’autres, l’usage de la parole, sans compter celles percluses depuis belle lurette dans leurs villages.
Elles sont toutes des veuves d’anciens combattants. Aujourd’hui frappées de sénilité, beaucoup d’entre elles portent dans leur chair de graves stigmates liés au grand âge. Certaines ont perdu la vue, d’autres, l’usage de la parole, sans compter celles percluses depuis belle lurette dans leurs villages.
Pour tous ces ayants droit, pour utiliser une expression consacrée, les jours de la paie de leurs pensions trimestrielles se suivent et se ressemblent : les mêmes conditions de tourment, d’affliction, d’humiliation et les mêmes affres.
De leurs patelins, parfois lointains, elles sont conduites, voire littéralement trimbalées par leurs enfants ou leurs petits-enfants, à Mobylette, dans le meilleur des cas, le plus souvent à vélo ou encore en wotoroni, ces charrettes à traction asinienne, jusqu’au bureau de la perception à Tougan, localité que nous avons ciblée, pour rester dans le jargon militaire, en raison de sa très forte concentration de tirailleurs au kilomètre carré. Nous étions le vendredi 1er décembre 2006.
Là, elles perçoivent, au prix de mille et une tribulations, la pension de réversion au titre de leurs maris défunts. Une portion congrue dont nombre de bénéficiaires en sont venues à se lasser tant la procédure d’obtention relève, c’est le cas de le dire, du parcours du combattant. Vous allez comprendre pourquoi.
Sept, c’est une de moins. La veuve Tiri Boro vient de toucher sa pension. Son petit-fils a aussitôt procédé à la répartition : « Une partie de l’argent servira à payer des ouvriers agricoles, le reste sera partagé en sept parties, c’est-à-dire entre nous les quatre petits-fils et mes trois oncles ». Dans la plupart des cas, c’est ça la clef de répartition. Mais la veuve Boro, 79 ans, n’en a cure. Elle se contente d’écouter son accompagnateur, indifférente, le regard perdu dans l’horizon, le foulard noué jusqu’aux oreilles, trouvaille bien connue de nos mamans contre l’harmattan. Le petit-fils, lui, a les yeux irrésistiblement rivés sur les billets de banque durant notre bref entretien.
Martyrisée par la mobylette déglinguée de marque L2 sur laquelle elle a été transportée de son village, Yankuèré, à 20 km de Tougan, la veuve vit depuis longtemps les jours de paie comme des moments de pires souffrances. Combien le Trésor public français lui a-t-il envoyé ? Encore et toujours 146,41 euros. Oui, 146,41 euros. C’est inscrit sur le petit bulletin blanc que la vielle femme tient en main avec quelque religiosité. 146,41 euros le trimestre. C’est, dans un certain sens, une broutille, une vraie misère même dans un pays aussi mal placé que le nôtre sur l’échelle IDH du PNUD. Convertissez en monnaie locale et convenez-en vous-même : 96 000 en francs CFA.
Et dire que veuve Boro n’est pas si mal lotie en comparaison d’autres bénéficiaires. Comme les autres jours de rendez-vous avec le percepteur, la quasi-octogénaire a encore passé une journée de fatigue, de tracas et de mortifications dont elle se serait bien passée. Et ce vendredi 1er décembre 2006, c’est de nouveau jour de supplices pour ces quelque trois cents veuves d’anciens combattants du département.
Rupture de stock d’imprimés de quittance
Première étape de cette longue et pénible odyssée qui mène à la caisse, ces bureaux de la préfecture où sont délivrées les quittances, ces précieux sésames, toujours établies au nom et en présence des bénéficiaires. Très tôt ce matin-là, la cour à la clôture grillagée grouille de veuves et d’accompagnateurs, malgré le froid glacial et les raids incessants de l’harmattan.
Y convergent sans discontinuer, perchées à l’arrière de mobylettes, de vélos sans âge, ou encore impassiblement assises dans des charrettes brinquebalantes à traction asinienne, des vieilles décaties, voûtées, la peau blanchie par la brise matinale, parfois les pieds nus et la canne à la main. Ici, un jeune homme appelle à l’aide pour faire descendre de sa monture une mère ou une grand-mère. Là, des volontaires soutiennent une grabataire, incapable de gravir les deux marches de l’estrade.
Dans le couloir du bâtiment de la préfecture, un ballet incessant de « mentors », pièces d’identité dans une main, bras inerte d’une génitrice ou d’une aïeule dans l’autre. Devant la première porte, un petit attroupement.
Se déclenche alors une petite bousculade. Des personnes courbaturées vacillent. Par mesure de prudence, une malvoyante quitte les rangs, aidée de son guide pour prendre place sur un banc. La voix fluette de la secrétaire du préfet se met à cracher quelques paroles à peine audibles. Nous apprendrons quelque temps après qu’elle venait d’annoncer une rupture de stock d’imprimés de quittance. Concert de grognements dans les rangs. Une autre voix, rauque cette fois-ci, se met à pester.
C’est celle de Guido Boro, un solide gaillard qui vient d’arriver avec sa grand-mère : « Lundi dernier, nous n’avons pas pu obtenir de quittance parce que le préfet était absent. J’ai dû confier la grand-mère à un ami avant de retourner au village situé à 25km de là. Aujourd’hui on nous dit que celui qui veut obtenir la quittance doit aller photocopier le seul exemplaire restant », fulmine de rage le jeune homme, en français. Puis de lâcher, dépité : « 100 francs la copie recto verso ! » Une fortune.
Peu corpulente, vêtue d’un tailleur cintré, chevelure d’ébène coupée à la garçonne, la secrétaire continue de seriner, l’air dédaigneux : « Il ne reste plus qu’un exemplaire de quittance. Il vous faut aller en faire une copie ». N’ayant pas su deviner à temps l’humeur du jour de la « maîtresse des lieux », notre équipe de reportage en aura pour son grade. Alors que nous nous avancions vers son bureau pour solliciter un rendez-vous avec le préfet, elle nous mitrailla d’abord d’un regard d’acier avant de nous autoriser, du bout des lèvres, l’accès au cabinet de son chef.
C’est vraiment écœurant
Mais, revenons à l’objet primordial de ce reportage. Tel un cheval piqué par une mygale, Ali Zerbo bondit dans le couloir. C’est un ami, plutôt un esclave que nous appelons avec force sympathie « le plus Moaga des Samos », pour son sens élevé des affaires. Propriétaire d’un taxi-brousse et d’un secrétariat public, il est également chaque matin dans son kiosque à café, servant lui-même la clientèle ou débarrassant les tables des restes de repas. Informé trois jours à l’avance de notre arrivée en pays san et surtout de l’objet de notre mission, Ali tient à apporter sa part de témoignage au sujet de la souffrance des guiè lô, ces veuves, en langue san.
Lui-même petit-fils de tirailleur Sénégalais, parce qu’il est très sollicité dans les villages pour son véhicule de marque Fiat qu’il met au service de ceux qui en font la demande, contre numéraires cela s’entend, les jours de paie sont lucratifs pour lui. Mais face à certaines situations, Ali a du mal à contenir son haut-le-cœur : « Voir toutes ces pauvresses endurer de longs trajets et venir souffrir devant la préfecture et le bureau de perception pour des pensions parfois dérisoires, c’est vraiment écœurant », s’offusque-t-il.
Même sentiment d’écœurement chez le président de l’association des anciens combattants, veuves, orphelins et anciens militaires de Tougan, le major à la retraite Dominique Zerbo que nous avons rencontré auparavant devant le bureau de la perception. Mine sépulcrale, paupières poussiéreuses, à peine nous a-t-il salué qu’il pousse un long râle de réprobation : « Voyez-vous, ce sont toutes de vielles femmes impotentes et malades. Mais on les oblige à effectuer de longs trajets de 40 à 50 km pour venir toucher la pension à Tougan. Parce qu’incontinentes, il arrive des fois que certaines se soulagent ici sur place au milieu de la foule.
Sans compter les nombreuses chutes en cours de route. Si vraiment vous, les journalistes, pouvez aider à trouver une solution à la situation, ça nous soulagera tous ». Puis le secrétaire général de l’association, Joseph Zerbo, de nous raconter l’histoire de cet ancien combattant mort cette année en cours de route, alors que son fils le conduisait à mobylette dans le chef-lieu du Sourou pour y percevoir sa pension.
Alors que nous quittions la préfecture pour le bureau de la perception, situé à quelque trois cents mètres de là, arrive, dans une charrette traînée par un âne, une autre veuve accompagnée de son petit-fils Pierre Boro. Infirme des membres supérieurs, Madeleine Drabo, 78 ans, ne peut monter ni sur un vélo, ni sur un quelconque engin à deux roues. Faute d’argent, sa famille ne peut non plus faire appel au taxi-brousse. Alors, comme tous les autres jours de paie, elle a été chaperonnée en charrette dont le seul confort est cette natte en plastique étalée à l’intérieur.
Après plus de trois heures de route sur une distance de 10 km, l’attelage haletant parvient enfin à destination aux environs de 10 heures. Le cocher se précipite dans la cour, disparaît dans le couloir de la bâtisse, pour réapparaître, suivi du préfet. Celui-ci est venu s’assurer de la présence effective de la pauvre femme aux allures de bohème. Une quittance est sitôt délivrée. Satisfaction de l’accompagnateur. Indifférence de la bénéficiaire clouée dans le coche, les jambes tendues, le corsage mal ajusté.
Deux coups de bâton sur les flancs et l’animal pivote sur ses pattes arrière, effectue un demi-tour réglementaire comme l’aurait fait une recrue ou plutôt un lacrou (1) de la coloniale, avant d’entamer une descente vers la perception. Lorsque nous lui demandons, magnétophone tendu, le montant de la pension de sa grand-mère, Pierre recule machinalement, se ressaisit, étouffe un rire avant de répondre tout simplement : « Je ne sais pas ». Il préfère nous tendre un ancien bulletin de paie : 88,42 euros par trimestre, soit environ 58000 francs CFA. Pour servir à quoi ? Entretenir une ribambelle de fils et leurs enfants.
Des carcasses décrépites chancellent, tels des blessés de guerre
Devant le bureau de la perception, une scène déprimante. Sous un arbre, est couchée en chien de fusil une vielle femme. Le pagne dont elle s’est couverte indique sans doute qu’elle souffre du froid, forcément sibérien pour ce corps décharné. A l’entrée du bâtiment, sur les escaliers, sont amassées d’autres veuves toutes prostrées, écrasées par le poids de l’âge. Certaines montent les marches à quatre pattes. D’autres en descendent, accroupies et à reculons.
De jeunes gens s’activent ici, pour faire descendre une grand-mère d’un vélo ou d’une mobylette, là, pour aider à monter une autre sur le porte-bagages d’une bicyclette du genre « strict minimum » comme on les baptise méchamment. Soutenues de part et d’autre de leurs carcasses décrépites, des mamies chancellent, tels des blessés de guerre vers le bureau de la perception. Dans le taxi-brousse, est prostrée depuis plusieurs heures une infirme attendant le payeur, qui doit l’y rejoindre du fait de son handicap.
Soudain, dans la cour, une voix de stentor retentit. Un agent de la perception procède à l’appel. L’une après l’autre, suivant l’ordre des noms, les appelées du jour répondent, de façon quasi automatique, parsent, pour dire présent :
![]() Zonla Scabo : Parsent !
Zonla Scabo : Parsent !
![]() Bara Moto : Parsent !
Bara Moto : Parsent !
![]() Yékimani Koné : Parsent !
Yékimani Koné : Parsent !
![]() Bara Kalandjibo : Parsent ! ...
Bara Kalandjibo : Parsent ! ...
Après vérification minutieuse d’une part, de la conformité du montant de la pension inscrit sur la quittance avec celui porté sur le registre du percepteur, et d’autre part, de la validité de la carte d’identité des veuves, commence la paie. Comme pour la quittance, la pension est remise face à face, main à main à la bénéficiaire dans le bureau du percepteur. Exceptionnellement dans la cour, pour celles frappées d’infirmité motrice. Comme c’est le cas de notre vielle couchée sous l’arbre.
Au moment de la paie, notre photographe, depuis longtemps aux aguets, sort son objectif et fixe des images. Colère du percepteur qui nous interdira d’en faire usage dans notre canard. Malgré nos supplications et l’intervention en notre faveur, d’abord du secrétaire général de l’association des anciens combattants, puis de la secrétaire générale de la province, l’argentier est resté inébranlable sur sa position (lire encadré).
C’est ce qu’on appelle « être payé en monnaie de singe »
Pendant que nous nous demandions comment faire pour prendre langue avec monsieur « l’enfeuilleur », déjà retourné à son guichet, la rancœur toujours tenace, une voix fine nous demanda en français : « Mon fils, ça va ? » Le visage amaigri et les yeux chassieux, la veuve Lobotoré Zerbo a suivi, à côté de son petit-fils, nos démêlées avec le percepteur. A 76 ans, la démarche un peu claudicante, elle semble plutôt bien conservée. Venue de Bassan à 12 km de là, elle se plaint plutôt du montant de sa pension que des conditions de son encaissement. Avec 118,13 euros le trimestre, à peine 77 500 francs CFA, loô soré, la vielle femme ne cache pas son amertume : « Avec ça, je dois acheter du mil pour aider mes douze enfants à entretenir une trentaine de petits-fils.
Vous croyez que je peux m’en sortir ? » Vers 12 heures, arrive en trombe du village de Soumarini, distant de 35km, une Peugeot 405 noire. Au volant, le président des anciens combattants. Sur la banquette arrière, la veuve Djiré Yabé, 83 hivernages à son compteur, soutenue par ses deux enfants. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas parler. Elle est presque couchée à l’arrière du véhicule, la peau collée aux os.
Quittance en main, l’un des accompagnateurs fonce directement vers le bâtiment de la perception, gravit presque trois à trois les marches de l’escalier, et le voilà nez à nez avec le maître des lieux. Mais, peine perdue. La carte d’identité de la pensionnée n’est plus valide depuis février dernier.
Refus du payeur de délier les cordons de la bourse. Les membres du bureau de l’association ont beau se ruiner en explications et en supplications de toutes sortes, rien n’y fera. L’établissement d’une nouvelle pièce est plus que jamais obligatoire. Commence alors une nouvelle série de tribulations pour Djiré Yabé pour une pension dont elle ne profitera pas vraiment. C’est ce que les Français appellent « être payé en monnaie de singe » pour ceux qui ont versé leur sang « noir » pour la « mère patrie ». Situation que la décristallisation des pensions décidée le 27 septembre dernier (Lire encadré), mais qui n’est pas encore effective, ne changera pas vraiment.
(1) Ainsi appelait-on par déformation les jeunes « recrues »
Alain Saint Robespierre
Le percepteur boudeur
Derrière ses apparences d’homme affable (taille élancée, démarche nonchalante et ton bien pondéré), se cache un caractère d’homme inflexible. Dans son bureau, déjà peu ouvert aux vents, où il nous a fait entrer peu après avoir fini de désintéresser la dernière pensionnée, le percepteur refusera de s’ouvrir à notre équipe de reportage. Pourtant, à la secrétaire générale de la province qui a sollicité son indulgence à notre égard après l’incident de la prise de photo, il a promis, au téléphone, de bien accepter de nous recevoir. Mais devant nous, et à notre grand dam, il se ravisera.
Comme si la présence de journalistes en ce jour suscitait en lui gêne et incommodité. Sur le moindre sujet relatif à la pension des anciens combattants ou à celle de leurs veuves, wari massa, trésorier en chef en langue dioula, comme certains se plaisent à l’appeler là-bas, n’en pipera pas mot : « Vous savez, avant mon affectation ici à Tougan, beaucoup de choses ont été dites au sujet des pensions », ne cesse-t-il d’opposer à nos multiples tentatives pour lui arracher quelques mots. Fait-il allusion à cette présumée affaire de détournement qui avait défrayé la chronique dans toute la province du Sourou et dont la gendarmerie s’était saisie ? Même du nombre d’anciens combattants toujours en vie dans le département, il fera un mystère inviolable digne des loges initiatiques.
Secret professionnel ? Volonté manifeste de nous faire payer notre audace de l’avoir photographié alors qu’il payait, sous un arbre, une pensionnée infirme ? Ou simple excès de zèle ? Sans l’autorisation quasi spéciale de sa hiérarchie de Ouahigouya, a-t-il fait comprendre, rien ne filtrera de son bureau. La seule petite faveur que le grand boudeur a daigné nous accorder, c’est de nous donner, d’abord, le numéro de téléphone portable de la directrice du Trésor de la région du Nord, puis celui de son fondé de pouvoir, tous deux inaccessibles lorsque nous avons tenté de les joindre.
Pourtant, combien de fois n’a-t-on pas entendu les reproches du genre : « Vous auriez dû venir à la source. Nous sommes toujours disposés à communiquer ». Alors, monsieur le percepteur, revoyez votre copie.
A. S.R.
L’Observateur